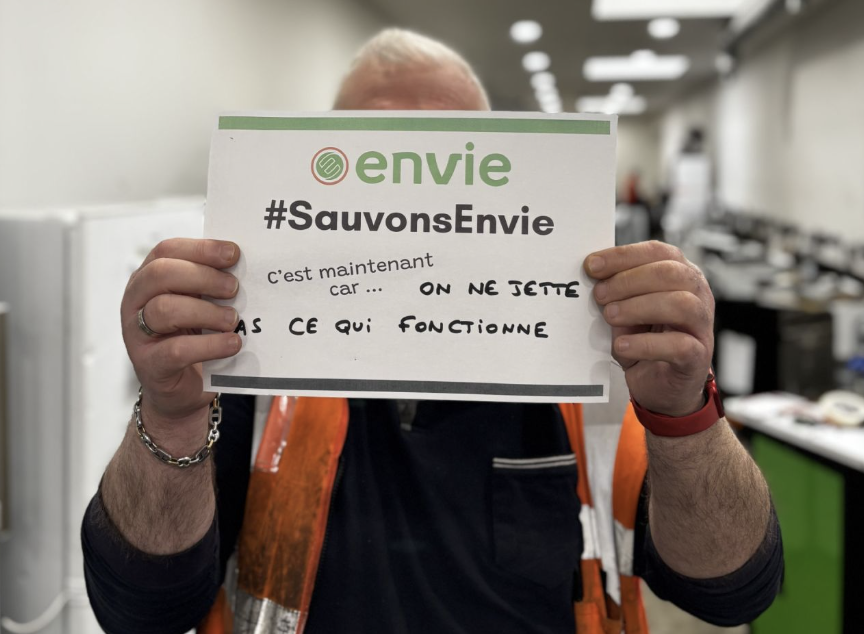Dans une économie où la circularité devient un argument clé pour séduire les consommateurs, les programmes de reprise d’électroménager s’affichent comme des solutions durables. Mais que se passe-t-il réellement une fois l’appareil emporté ? Hugo Clément et les équipes de Sur le Front ont mené un travail d’investigation pour mettre en lumière les limites de la loi AGEC sur la reprise.
Un client, soucieux de connaître le sort de son ancien frigo, demande à son distributeur s’il sera réemployé. Réponse : « Oui, il repartira dans le circuit de la seconde main ». Curieux (et méfiant), il installe un traceur GPS à l’intérieur de l’appareil.
Résultat ? L’appareil est collecté, comme promis, mais n’est jamais localisé dans un centre de reconditionnement, ni dans une filière de traitement identifiée. Une disparition silencieuse qui interroge. Et révèle, en filigrane, les failles d’un système encore fragile.
Retrouvez la vidéo d’Hugo Clément sur la reprise et l’intégralité du reportage sur france.tv.
Une promesse séduisante, une traçabilité absente
Avec la montée des préoccupations environnementales, la reprise d’équipements usagés au moment de l’achat d’un produit neuf est devenue un argument marketing fort. Sur le papier, tout est aligné :
- Réduction des déchets
- Allongement de la durée de vie des équipements
- Réinjection de produits dans un marché d’occasion encadré
Mais dans les faits, la traçabilité fait souvent défaut. Le cas du traceur perdu illustre l’absence d’un système de suivi ouvert, accessible au consommateur. Si des plateformes comme ecosystem opèrent avec des partenaires certifiés, aucun outil ne permet aujourd’hui de vérifier le parcours réel de l’objet confié.
Pourquoi ces promesses peinent à se concrétiser
Plusieurs facteurs expliquent ce décalage entre les engagements affichés et la réalité terrain :
1. Un coût logistique sous-estimé
Acheminer un appareil, le diagnostiquer, le nettoyer, le réparer, puis le tester : autant d’étapes coûteuses, surtout pour des appareils volumineux. Il est parfois plus simple (et rentable) pour l’acteur intermédiaire de rediriger l’objet vers la casse ou l’export, surtout en l’absence d’obligation de réemploi effectif.
2. Des volumes disparates et irréguliers
Les structures de reconditionnement ne disposent pas toujours d’un flux stable ou homogène de produits récupérés. Résultat : certains centres n’acceptent que les appareils les plus récents ou réparables rapidement, reléguant les autres au rebut.
3. Un manque de transparence sur la chaîne de valeur
La reprise est souvent sous-traitée à des prestataires multiples. Dans cette chaîne étendue, la responsabilité devient diluée. Le distributeur promet, le logisticien collecte, mais qui garantit le réemploi ?
Un vrai enjeu industriel et politique
Le gouvernement, à travers la loi AGEC (anti-gaspillage pour une économie circulaire), pousse à la responsabilisation des producteurs via la REP (Responsabilité Élargie du Producteur). En théorie, cela implique que chaque appareil repris doive connaître une fin de vie valorisante (réemploi, recyclage).
Mais l’encadrement réglementaire reste flou sur les indicateurs de performance en matière de réemploi. On parle en tonnes traitées, en taux de recyclage… très peu en nombre d’objets remis sur le marché.
Il manque :
- Des indicateurs publics de traçabilité
- Des objectifs chiffrés de réemploi effectif
- Un suivi individualisé que le consommateur puisse consulter
Un effet boomerang sur la confiance des consommateurs
La promesse non tenue de reprise frigo seconde main fragilise l’ensemble du secteur. Pour un consommateur de plus en plus sensibilisé, l’opacité équivaut à du greenwashing.
Le risque ?
- Une perte de confiance dans les distributeurs
- Une remise en cause des dispositifs publics de soutien à la réparation
- Une réticence à utiliser les circuits de reprise, au profit d’une mise en déchetterie directe
Des pistes d’amélioration concrètes
Pour crédibiliser les dispositifs de reprise, plusieurs leviers existent :
1. Traçabilité numérique : Mise en place d’un QR code ou d’un outil de suivi en ligne accessible au client (type suivi colis)
2. Label “reprise garantie en seconde main” : Créé et contrôlé par un organisme tiers, ce label garantirait que l’appareil est bien reconditionné ou recyclé en France
3. Indicateurs publics de performance : Nombre d’objets reconditionnés, réemployés ou démantelés avec valorisation matière
4. Responsabilisation contractuelle des sous-traitants : Chaque acteur de la chaîne devrait être tenu comptable du sort de l’équipement

Et si le don devenait l’alternative la plus crédible ? L’exemple de Geev Pro
Face aux limites actuelles de la reprise électroménager, certaines solutions alternatives émergent — plus simples, plus transparentes et souvent plus efficaces. C’est le cas de Geev Pro, une offre B2B proposée par la plateforme de dons entre particuliers Geev. Geev a déjà conclu un partenariat de ce type avec Ixina.
Le principe : permettre aux marques et distributeurs d’offrir à leurs clients une solution de don lorsqu’ils souhaitent se débarrasser d’un appareil encore fonctionnel. Plutôt que de passer par un circuit opaque ou coûteux, l’utilisateur est incité à faire un don localement, en quelques clics, via une interface personnalisée et intégrée à son parcours d’achat ou de reprise.
Pour l’entreprise, c’est :
- Un outil de fidélisation éthique
- Une preuve d’engagement RSE concrète
- Une façon de décongestionner les flux logistiques
Pour le consommateur, c’est :
- Une action simple et valorisante
- L’assurance que son bien servira vraiment à quelqu’un
- Une alternative sans greenwashing
Geev Pro illustre ainsi une autre voie : celle du don comme premier réflexe circulaire, à condition qu’il soit bien outillé, soutenu et valorisé par les marques.
Conclusion : réemployer, oui — mais avec des preuves
La reprise frigo seconde main est une promesse forte, mais encore trop fragile. Pour que le citoyen adopte durablement ce réflexe, il faut des garanties. Traçabilité, transparence, responsabilité : ces trois piliers doivent devenir la norme.
Derrière l’expérience d’un consommateur méfiant se cache une réalité : le réemploi ne se décrète pas, il se construit. Et il commence par la confiance.